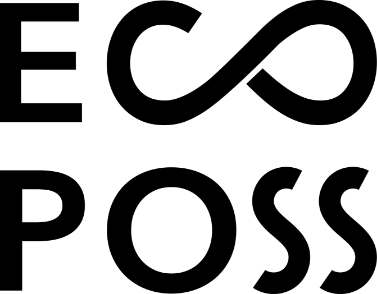Des corps emmitouflés dans d’épais manteaux sur le sol, certains, face contre terre, les mains liées dans le dos, une victime n’a pas eu le temps de descendre de son vélo. Les images de Boutcha en Ukraine sont saisissantes. Elles ont fait le tour du monde et réveillées, au passage, certaines interrogations. Faut-il montrer ces images ? Les montrer, est-ce banaliser la violence, banaliser la guerre ?
Depuis le XXème siècle, certaines représentations de la violence sont considérées comme un danger, notamment pour la jeunesse. C’est le cas d’images extrêmes comme des décapitations. Elles sont à l’origine du système de classification des films et des premières mesures de contrôle de la captation et de la diffusion. « Les sociétés se construisent à partir d’interdits », explique Sophie Jehel, professeure en information et communication, « la représentation de la violence létale et des violences réelles font partie des sujets qui vont susciter des formes d’inquiétudes ». Dans ce contexte les premiers organismes de régulation des médias audiovisuels vont apparaître. L’Arcom, ex-CSA naît en 1989. Les chaînes veillent depuis à ce que les programmes ne heurtent pas les mineurs.
A partir de 2004, les plateformes interactives et réseaux sociaux prennent leur essor. Une rupture technologique. Dorénavant, les images de violences occultées par la télévision se retrouvent en libre diffusion sur internet. L’arrivée des smartphones en 2010 va définitivement contourner le système de régulation existant. Sophie Jehel constate, « les jeunes ont accès à des contenus de moins en moins régulés et de plus en plus violents ». Des voix s’élèvent dans le milieu scientifique pour dénoncer l’impact qu’elles pourraient avoir sur le cerveau. Mais cet impact, est-il réel ? Assiste-t-on vraiment à un effet d’accoutumance à la violence ? Selon la chercheuse, « cela n’est pas automatique ». Les mêmes images peuvent susciter aussi bien l’indifférence, qu’une certaine montée de l’agressivité, ou encore de l’anxiété.
Entre radicalité et rationalité
« On a tendance à croire à une unité des comportements des jeunes face à des images violentes, la réalité est plus contrastée ». Sophie Jehel déconstruit nos idées reçues. Entre 2015 et 2017, elle a mené une enquête auprès de 90 adolescents issus de milieux sociaux très variés. Les résultats sont surprenants.
La chercheuse a identifié quatre catégories de comportements : l’adhésion, l’indifférence, l’évitement ou l’autonomie. Dans le cas de l’adhésion, l’internaute n’a aucune emprise sur ses émotions. Il ressent plus qu’il n’interroge l’image. Cet effet peut mener à de la sidération. « Les jeunes vont aller chercher ces images par eux-mêmes », certains deviennent accros. Et de constater, ce sont les adolescents déjà confrontés dans leur vie à des formes de violences qui sont les plus addicts. Visionner des vidéos violentes n’a alors pas d’effet thérapeutique ou cathartique comme l’avancent certaines théories, mais est la « répétition d’un traumatisme ». Parfois, l’adhésion va jusqu’à des « formes de radicalisation ». Dans ce cas, affirme Sophie Jehel, « la représentation de la violence peut renforcer sa légitimation, la rationaliser ».
Certains jeunes, ressentent de l’impuissance face à l’omniprésence de la violence. Ils se résignent et ne cherchent pas à l’éviter. D’autres au contraire, fuient ces images. En général, les filles prennent garde à ne pas visionner des images trashs qui pourraient porter atteinte à leur image ou à leur réputation. Enfin, la réaction la plus saine, selon la chercheuse, est ce qu’elle appelle l’autonomie. On s’approprie « l’image comme une représentation et non comme la réalité directe ». On sait qu’« il y a une intention derrière, un contexte, une source, une date, etc. ». On choisit de la regarder ou non, précise-t-elle. « Derrière, se trouve l’idée de construire son propre point de vue ».
« Le fait de les voir jeune reste préoccupant »
Néanmoins, « l’augmentation du nombre d’images violentes et le fait de les voir jeune, reste préoccupant », admet-elle. Est-ce que cela nous promet une société plus violente ? Une certitude, le fait de protéger les enfants fait partie de la préservation de leur équilibre.
La situation est due en partie au laisser-faire des plateformes. Une question se pose : peut-on les amener à réguler leur contenu ? L'Union européenne souhaite renforcer la transparence des algorithmes, mais les GAFAM parlent de secret d’affaires. Elles ne fournissent que peu d’informations. La seule indication est celle de la quantité de contenus dans les « transparency report », où l’on constate « des volumes toujours plus élevés de contenus supprimés ». Facebook, par exemple, supprime plus de comptes qu’il n’en a. Une piste, propose la chercheuse, serait d’obtenir une connaissance précise des contenus supprimés. Plutôt que d’espérer une transparence totale des algorithmes, « que nous n’obtiendrons jamais », elle milite pour que des chercheurs indépendants ou des pouvoirs publics puissent accéder à « la grande poubelle des plateformes ».
Une autre piste est la modération. On manque de modérateurs en France, alerte la chercheuse. « Les pouvoirs publics doivent obtenir davantage de modération dans la langue française ». Et la dure réalité du métier de ces nettoyeurs du web ne facilite pas ce travail. Confrontés à des images violentes tout au long de la journée, beaucoup se retrouvent en situation de détresse psychologique, certains ont porté plainte contre leurs employeurs.
L’éducation aux médias reste une étape cruciale. Pour Sophie Jehel, nous avons le devoir d’expliquer aux jeunes que « ces espaces ne sont pas des espaces de non-droit ». Toute personne qui promeut des discours de haine en ligne peut être sanctionnée pénalement. Il faut également créer des espaces dans lesquels les internautes réfléchissent à ce qu’ils font sur ces plateformes. L’école a un rôle majeur à jouer, mais on est « confronté à un manque de formation des enseignants et une éducation à l’image insuffisante ».
« C’est ma mère qui me l’a montré »
Les parents ont aussi leur rôle à jouer. Lors de son enquête, Sophie Jehel s’est rendu compte que les adultes se laissent aussi emporter par leurs émotions face à des images violentes. Certains jeunes admettent volontiers que ce sont leurs parents qui leur fournissent ces images. « C’est ma mère qui me l’a montré », a témoigné un adolescent, se souvient-elle. Puis, de conseiller, « vous pouvez parler des images que vous avez-vu, plutôt que de leur montrer ». Il faut réussir à prendre de la distance. Selon les milieux, les habitudes ne sont pas les mêmes. On observe un écart entre les parents de milieux favorisés, plus à même d’accompagner leurs enfants dans l’éducation au numérique, et les parents aux revenus plus faibles. Dans les milieux populaires, « les médias ont une aura » qui n’est pas sans répercussions. On équipe plus facilement un enfant d’un smartphone. Laisser l’enfant devant des dessins animés ou jouer avec une tablette, seul, facilite la vie des adultes.
Sophie Jehel conclue sur ses mots. La période que nous vivons en ce moment, avec la pandémie et la guerre à nos portes, est « déstabilisante ». Les images, violentes. Pour s’en protéger, il est nécessaire de prévoir des « temps » où l’on n’est pas exposé à ces violences sans pour autant nier leur existence, mais pour les regarder avec davantage de recul.
Bérénice ROLLAND
Même sujet
-
14.06.2024Image

 ECOPOSS
ECOPOSSLes défis de la contraception masculine
De quoi s’agit-il aujourd’hui ?Voir plusLorsque l’on parle de contraception dite masculine, la plus connue et plus utilisée est le préservatif. Il s'agit du seul contraceptif à protéger des infections sexuellement transmissibles (IST). Il existe également la stérilisation masculine grâce à la va..
-
01.03.2022Image

 ECOPOSS
ECOPOSS[Veille] « Renoncer à faire des enfants pour des raisons écologiques n’aura qu’un effet mineur »
Voir plusVia Usbek et Rica
« Rien ne rejette plus de carbone qu’un humain dans notre monde développé. Alors, pourquoi avoir fait un enfant ? […] Vous allez condamner d’autres gens à souffrir. Si vous voulez vraiment préserver l’environnement, il faudrait plutôt trancher la gorge de ce gamin et t..
-
28.02.2022Image

 ECOPOSS
ECOPOSS[INTERVIEW] Eliane Le Jeune-Bézard et Jean-Marie Bézard : « Être parent se construit progressivement »
Voir plusOn retrouve souvent dans vos travaux la notion de “devenir parent”, que signifie-t-elle ?
Eliane : Parents, c‘est une personne qui prend la responsabilité, pour aimer d’un amour inconditionnel, éduquer et accompagner l’enfant, le jeune, l’adulte dans sa vie. Elle lui donne ..